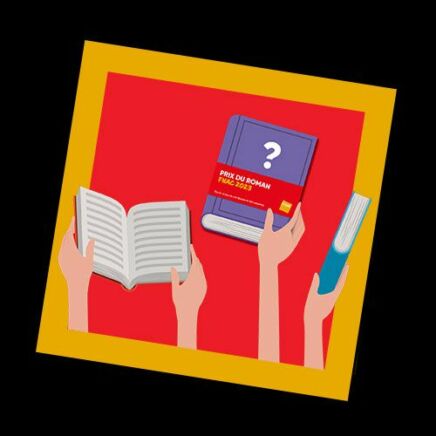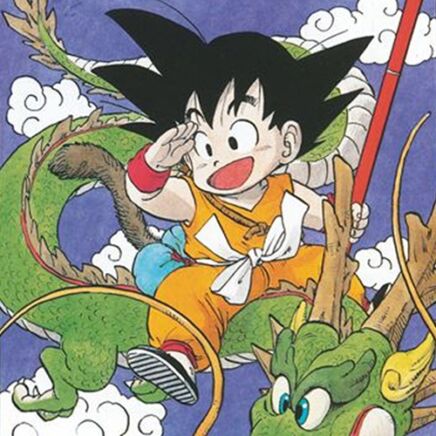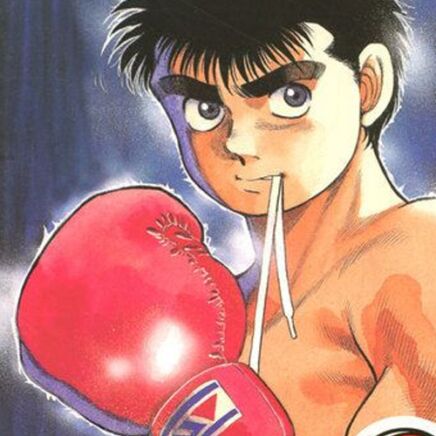Jusqu’au 26 juillet, Avignon donne rendez-vous aux amoureux du théâtre. Comme chaque année, le choix est vertigineux : pas moins de 1 724 spectacles sont programmés dans le Off, répartis dans les 139 théâtres de la ville, et une quarantaine de propositions composent la sélection officielle du In. Vous ne faites qu’un court passage dans la cité des Papes ? La rédaction de L’Éclaireur vous propose un itinéraire resserré, mais inspiré : trois pièces du In à ne pas manquer, et dix propositions repérées dans le Off, pour composer un parcours riche, poétique et intelligent – entre grandes signatures, révélations audacieuses et instants de grâce.
Le In du Festival d’Avignon
1 La distance
Au plateau, un décor simple et tournant : deux comédiens incarnent un père et sa fille séparés par des années-lumière. Nous sommes en 2077. Amina, la fille, s’est envolée pour Mars dans le cadre d’un programme expérimental. Là-bas, elle devient une « oubliante », soumise à un protocole de perte progressive de mémoire. Ils dialoguent à distance, par écrans interposés. « Nous, on ne croit plus que ce soit possible de changer le monde. Nous croyons qu’il faut changer de monde », déclare la fille unique de l’homme interprété par Adama Diop.
Tiago Rodrigues, auteur et metteur en scène – actuellement directeur du festival –, imagine ici un prétexte de science-fiction pour interroger nos rapports au temps, à la mémoire et à l’amour quand tout devient différé. Entre les deux personnages, le temps est compté. Alors, on se dit ce qu’on ne dit jamais : les peurs, les failles, les doutes. Peut-on partir sans prévenir ? Peut-on aimer sans souvenir ? Peut-on être là, malgré l’absence ?
La pièce parle de ces distances qui s’installent insidieusement dans nos existences, bien avant les voyages interplanétaires : celles liées au réchauffement climatique, à l’individualisme, à la solitude numérique. Tiago Rodrigues offre un théâtre de la fragilité, où les mots deviennent des gestes d’amour différé. Il prouve, avec tendresse, qu’on peut être présent même dans l’absence. Et c’est une franche réussite.
2 Fusées
Encore une proposition qui nous emporte dans l’espace. Sur scène, quatre interprètes cabossés déballent le décor en direct, devant le public. Des cartons, quelques objets hétéroclites et beaucoup d’imagination : il ne faut rien de plus pour que surgisse sous nos yeux un cosmos de fortune.
Après un petit cours accéléré sur le système solaire et un détour par le Big Bang, nous voilà embarqués dans une station spatiale aux côtés de deux spationautes coincés en orbite. Très vite, une intelligence artificielle prénommée Viviane fait irruption : elle n’a rien d’un robot hollywoodien, mais impose une présence à la fois comique et troublante. Avec peu de moyens, mais une inventivité débordante, Vladislav Galard, Sarah Le Picard et Jan Peters signent une odyssée burlesque qui détourne les codes de la science-fiction pour mieux stimuler l’imaginaire. Une table de pique-nique suffit à créer l’apesanteur, un jeu de lumières à simuler l’infini.
Fusées, c’est aussi une histoire de liens : entre les humains et la technologie, mais surtout entre les corps, les voix, les regards. Une œuvre collective et ludique, qui interroge notre besoin d’ailleurs tout en célébrant la puissance de la fiction partagée. Une pièce solaire, drôle et malicieuse, qui témoigne de la force de l’imagination. À voir en famille – ou pour réveiller l’enfant qui sommeille en vous.
Fusées, 55 mn. En tournée dans toutes la France à partir de novembre 2025.
3 Affaires familiales
« La langue du droit n’est pas la langue du commun », prévient l’un des sept comédiens, dans la peau d’un avocat. Cette phrase sonne comme un avertissement : ici, la justice sera disséquée dans sa complexité, ses absurdités parfois, et surtout dans ses impacts sur l’intime. Émilie Rousset, autrice et metteuse en scène, signe une pièce-enquête sobre sur le système judiciaire et ses angles morts, notamment en matière de droit de la famille. À partir de rencontres menées avec des avocates spécialisées dans les droits LGBT, des mères dont les enfants ont été victimes de violences sexuelles, ou encore une policière catalane de la Mossos d’Esquadra, Affaires familiales tisse une polyphonie de récits.
Sur un plateau épuré – qui évoque la neutralité d’un tribunal ou d’une salle d’attente et, littéralement, la loi –, les témoignages enregistrés se mêlent à ceux incarnés par les comédiens, brouillant la frontière entre réel et fiction. Face au public, une femme raconte comment les procédures judiciaires l’ont « déréalisée ». Une autre évoque sa difficulté à nommer l’inceste auprès de ses enfants. Les avocats, eux, alertent sur les dérives d’interprétation du droit. Peu d’échappées lumineuses : même si des avancées sont évoquées, c’est bien la violence institutionnelle – lente, froide, parfois incompréhensible – qui domine. Sans pathos, avec une grande lucidité, Émilie Rousset met en scène l’opacité d’un système qui prétend dire la vérité, mais oublie parfois l’humain. Une pièce nécessaire, inconfortable et précieuse.

Le Off du Festival d’Avignon
1 Nos prochaines vacances ensemble
Et si, au lieu d’aller au théâtre, vous preniez un peu de vacances ? Sur scène, comme parfois en vacances, les choses ne se passent pas toujours comme prévu. Le début déroute, puis la poésie s’empare peu à peu de nos questionnements. C’est quoi, les vacances ? Une grille de mots fléchés sur la plage ? Un trajet en bateau ? Est-on vraiment en vacances quand on parvient à débrancher son cerveau, au point de ne plus rien ressentir ? La compagnie Neuve interroge notre capacité à nous offrir un espace – dans le monde actuel comme dans nos pensées.

Pendant plus d’une heure, on se laisse bercer par ce qu’on a rarement le temps d’apprécier dans nos quotidiens : le craquement de nos pas sur la neige, la douceur d’une amie bienveillante ou encore la liberté au sein d’un groupe. Chaque spectateur aura sans doute sa propre conception des vacances, mais, ici, le théâtre nous invite à y réfléchir ensemble. Et si aller au théâtre, c’était déjà partir en vacances ? Une chose est certaine : les quatre comédiens sont d’excellents guides vers la déconnexion.
Nos prochaines vacances ensemble, Théâtre du Train Bleu (40, rue Paul Sain), jusqu’au 24 juillet (les jours pairs), à 15h10, 1h20.
2 L’art d’avoir toujours raison
Comment accéder au pouvoir dans un état démocratique ? Deux scientifiques du Groupe interdisciplinaire de recherche pour l’accession aux fonctions électorales (le Girafe) prétendent avoir trouvé la méthode. Ils la partagent avec nous dans une conférence aussi drôle qu’instructive. S’appuyant sur les stratégies de grandes figures politiques contemporaines – et d’autres moins connues –, Adeline Benamara et Sébastien Valignat, deux interprètes brillants, décortiquent les usages des mots, les outils de communication et les ficelles rhétoriques du pouvoir.

Si vous avez toujours voulu savoir comment construire un bon programme électoral, faire disparaître le conflit, parler quand vous n’avez rien à dire… ou même manipuler vos proches, ce cours d’autodéfense intellectuelle hilarant est fait pour vous. Il s’adresse aussi aux spectateurs amoureux des mots et à ceux qui veulent comprendre leur méfiance face aux discours politiques.
L’art d’avoir toujours raison, Théâtre Le 11, jusqu’au 24 juillet (relâche le 18), à 17h35, 1h15.
3 Ce pays qui nous était destiné
Un ancien couple se retrouve sur une île après 12 ans d’absence. Anna, grande star de cinéma, a décidé d’y finir ses jours et convoque Louis, professeur de philosophie, pour rédiger ses mémoires. Leurs retrouvailles ? Électriques et dramatiques. « La vie en général, c’est pas une bonne idée », « Tu es la seule personne qui m’insulte avant de me dire bonjour »… Les punchlines s’enchaînent jusqu’au moment du bilan, des regrets et des règlements de comptes. Dans un décor de cinéma, ils se remémorent une histoire d’amour intense et complexe : la fuite soudaine d’Anna, le mal-être de Louis… Les passions s’enflamment.

Qu’est-ce donc que l’amour ? Un support, un partage, une consolation, des regrets, du vacarme, de la colère. Le jeu est aussi puissant que les sentiments qui ressurgissent. L’ensemble est d’une justesse remarquable. Un grand bravo à Aurore Paris pour le texte, et à Vanessa Fonte et Vincent Menjou-Cortès (qui signe aussi la mise en scène) pour leur interprétation.
Ce pays qui nous était destiné, Théâtre Le 11, jusqu’au 24 juillet (relâche le 18), à 18h25, 1h15.
4 Annette
« Ça fait mal, trop d’émotions, tout ça. Quand j’étais petite, je pensais que ce serait plus facile à vivre. » C’est l’histoire d’une rencontre. Celle d’Annette, 75 ans, une femme authentique, touchante, et un brin rock’n’roll, qui a toujours refusé de rentrer dans les cases. Lorsque la metteuse en scène Clémentine Colpin croise son chemin, elle tombe sous le charme. Nous aussi. Annette n’est ni comédienne, ni danseuse. Et pourtant, elle est là, sur scène, sans pudeur ni chichi, pour raconter ses aventures, ses doutes et ses joies. Elle danse aussi. L’amour, la maternité, l’homosexualité, la ménopause, le corps vieillissant, la mort… Aucun sujet n’est tabou. La sexualité ? « C’est chronophage. » L’amour ? « C’est un marécage. »

Elle délivre aussi des conseils : s’offrir du temps, s’autoriser des challenges. La pièce qui porte son nom est touchante, sans jamais masquer les complexités d’une vie. Deux comédiennes et deux danseurs l’accompagnent dans cette mise à nu qui à aucun moment ne met mal à l’aise. Ensemble, ils construisent une polyphonie, affirmant – pour reprendre les mots de Clémentine Colpin – « qu’on est toujours plusieurs à l’intérieur de soi, et que le temps de l’esprit humain n’est jamais linéaire ». Un spectacle-hommage à ne pas manquer.
Annette, Théâtre des Doms (1 bis, rue des Escaliers), jusqu’au 25 juillet (relâche les 19 et 23 juillet), à 13 h, 1h50.
5 Ce que j’appelle oubli
« On ne tue pas un homme pour ça. » On ne tue pas un homme parce qu’il a soif et qu’il ouvre – et boit – une canette de bière dans un supermarché. Sur un plateau dépouillé, pour seul décor deux rideaux de bandes plastiques, un homme – le magistral Luc Schiltz – déroule, ou plutôt crache, vomit, mitraille un texte poignant de Laurent Mauvignier. Une parole à bout de souffle, vertigineuse. Cette fiction inspirée d’un fait divers lyonnais de 2009 interroge la mort, l’oubli, l’identité, l’appartenance, la solidarité et l’amour.
Avoir soif, qu’est-ce que cela signifie vraiment ? Est-ce qu’une allure peut déclencher l’irrémédiable ? Peut-on toujours comprendre ce qui fait basculer un geste ? Combien vaut une vie ? Un pack de six bières ? De 12 ? De 24 ? Sur scène, Jorge De Moura accompagne Luc Schiltz avec une partition musicale tout aussi puissante : rock, métal, électro, jazz… Ses notes résonnent comme des uppercuts, révélant la barbarie de nos sociétés. Cette fable philosophique et sociétale invite à regarder l’autre, à ne plus détourner les yeux. « Le scandale, ce n’est pas la mort, c’est la mort pour ça. » Quels actes justifient d’autres actes ? À quels moments les mots ont-ils le droit de s’effacer ? Un monologue intense qui retient les souffles, la colère et parfois les larmes.
Ce que j’appelle oubli, Théâtre Le 11, jusqu’au 24 juillet, à 11h45, 1h15.

6 Negative Space
Six comédiens aux costumes poussiéreux portent à la scène la violence de l’enfermement et les interactions nouvelles qui en découlent. Que fait-on dans un espace clos et inconnu ? Quelles sont les règles ? Faut-il des règles ? Les artistes de cette compagnie britannique tombent des murs, ouvrent des trappes, démolissent des parois. Dans cette boîte à outils, on se découvre, on se jette, on se retrouve. On soupire aussi. On repousse le néant, on écoute le silence des murs. Et on déconstruit. Les postures changent en fonction des autres, les sentiments fusent. Le tout, en silence. Un tableau visuel jouissif, drôle, contemplatif et existentiel. Negative Space est une expérience qui rappelle la force du collectif et des corps en mouvement. À celles et ceux qui préfèrent la physicalité et les sens à la communication banale, laissez-vous emporter ! Et pour les autres, laissez-vous guider par l’absurde.
Negative Space, La Manufacture (2, rue des écoles), jusqu’au 16 juillet, à 10h10, 1h50.
7 Illusions
Qu’est-ce que le véritable amour ? Et s’il ne pouvait être que réciproque ? Et si nos vies n’étaient qu’une suite d’illusions, qu’adviendrait-il de l’amour ? Quatre narrateurs s’emparent de ces questions à travers les récits de Dennis, Sandra, Albert et Margaret – deux couples mariés, à l’orée de leur mort. Sur scène, les histoires s’entrelacent et les frontières se brouillent. Lior Aidan, Maxime Allègre, Charles Montélimard et Laura Opsomer Mironov nous embarquent dans une vaste quête : comprendre notre rapport à l’amour et au couple, tout en tentant de distinguer le vrai du faux. De simples témoins, nous devenons partenaires.
On oublie le théâtre ; ce qui compte ici, c’est d’écouter l’autre pour mieux se découvrir soi-même. « Il doit bien y avoir un minimum de constance dans ce cosmos changeant », répète l’un des comédiens. Et, dans ce joyeux paradoxe, la fiction finit par embrasser l’intime. La mise en scène, signée par le collectif On finit bien par comprendre, repose sur un principe simple, mais essentiel : raconter ensemble, en direct. Les narrateurs ne se contentent pas de dérouler une histoire, ils la vivent, se laissent troubler, s’inventent des liens. Un spectacle déroutant, délicat et magnifiquement interprété, qui fait résonner nos propres illusions.
Illusions, Théâtre du Train Bleu (40, rue Paul Saïn), jusqu’au 24 juillet (les jours impair), à 13h05, 1h25.
8 L’abécédaire acrobatique #1
Et si on réinventait l’abécédaire ? Non pas pour réciter une liste figée de mots, mais pour les éprouver physiquement, les malaxer, les retourner, les faire vibrer dans l’espace. Avec L’abécédaire acrobatique #1, trois interprètes – deux circassiens et un comédien – s’emparent de la pensée de Gilles Deleuze et nous invitent à une expérience : penser avec le corps. Quatre mots leur servent de boussole : fidélité, résister, désir, enfance. Mais ici, pas question de donner une leçon ; on entre dans la philosophie par la pratique. Les gestes dialoguent avec des extraits sonores de Deleuze. Les mots s’incarnent, se déclament, pendant que les corps s’empilent, chutent, se relèvent, la tête en bas, l’esprit en éveil.
Les mouvements deviennent mots, les mots deviennent matière. La joie s’équilibre, un duo mordant s’invente avec une chaise, des micro-événements chorégraphiés s’invitent au plateau. On s’amuse des accidents, on synchronise, on extrapole aussi. Quand il est question de « résister », on observe ce qui plie ou lâche. Sur « désir », les corps s’organisent en agencements collectifs, empilant les gestes et les intentions. Pour « enfance », on fait surgir la mémoire. Un abécédaire vivant, où le cirque se mêle à la philosophie.
L’abécédaire acrobatique #1, L’Atelier – La Manutention (4, rue des Escaliers Sainte‑Anne), jusqu’au 20 juillet (relâche le 15), à 16h15, 1h10.
9 Diva syndicat
Sur scène, deux héroïnes musiciennes – ou peut-être des musiciennes héroïnes – s’interrogent sur l’absence criante des femmes dans l’histoire de la musique. Du Moyen-Âge à nos jours, d’Hildegarde de Bingen à Aya Nakamura, en passant par Clara Schumann, elles explorent ce qui devrait constituer les grands classiques du genre… mais qui reste relégué à l’oubli. Avec humour et énergie, Diva syndicat réinvente dix siècles de musique occidentale au féminin. Si l’invisibilisation des femmes est une thématique sérieuse, les deux divas s’amusent des stéréotypes et racontent ces destins autrement.

Chaque figure évoquée mériterait sans doute un spectacle à elle seule. Mais ici, le parti pris est clair : donner à voir, à entendre, à découvrir un maximum de compositrices en un temps donné. Écouter de la musique, c’est un plaisir. Mais c’est aussi une responsabilité. Diva syndicat nous propose d’être acteurs et actrices du changement. Une réécriture joyeuse et nécessaire de notre patrimoine musical. C’est frais, impeccablement chanté et mordant.
Diva syndicat, à LaScierie (15, boulevard Saint-Lazare), jusqu’au 26 juillet (relâche le 22 juillet), à 16h05, 1h05.
10 Rêves
Sur scène, ils défient la gravité, mais aussi la réalité d’un quotidien bouleversé par la guerre. Dans leur dernière création intitulée Rêves, les artistes du cirque Inshi livrent un spectacle de virtuosité, témoignage poignant d’une jeunesse ukrainienne renversée par le conflit. Dans une ambiance de clair-obscur, les corps s’élancent avec précision. L’écriture chorégraphique est ciselée, les gestes sont tendus, vibrants, habités d’une détermination farouche – celle de vivre, de résister… et de continuer à rêver.
L’une rêve de revoir son proche parti au front. Un autre de rencontrer Dieu. Ces confidences, esquissées au creux de la performance, ajoutent une sincérité bouleversante à ce cirque sous tension qui oscille entre lyrisme et combat. Fondé en 2020, en plein confinement, le cirque Inshi a été imaginé par Roman Khafizov et Volodymir Koshevoy, deux figures du cirque ukrainien. Ils ont réuni autour d’eux une équipe issue de l’École nationale de cirque de Kiev – l’une des plus prestigieuses au monde.
Trois spectacles sont nés, joués 107 fois en Ukraine, devant plus de 23 000 spectateurs. Mais le 24 février 2022, tout s’arrête. L’invasion russe bouleverse la vie culturelle du pays. Le cirque se tait et les représentations cessent. Aujourd’hui, ces jeunes circassiens reviennent sur scène avec une création inédite et émouvante, rarement présentée en France. Entre confession et prouesse, ils nous offrent une expérience de cirque aussi exigeante qu’essentielle.
Rêves, au Théâtre du Chêne noir (8, rue Sainte-Catherine), jusqu’au 26 juillet (relâche le 22 juillet), à 19h15, 1h15.